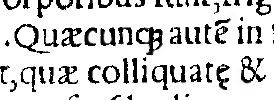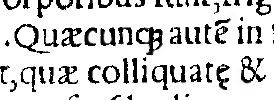|
Subject: |
Re: Règles typo pour le latin |
|
Date: |
Wed, 28 May 2003 23:34:59 +0000 |
|
From: |
Jacques Melot <jacques.melot@xxxxxxxxx> |
Title: Re: Règles typo pour le
latin
Le 28/05/03, à 13:50 -0400, nous recevions de Jean
Fontaine :
À propos de latin, quelqu'un
pourrait-il préciser ces points concernant
l'utilisation de la ligature æ {ae} en latin et en français ?
- Le latin d'origine n¹utilisait pas cette ligature, qui serait
apparue
tardivement. Quand, déjà ?
Elle est médiévale, comme une foule d'autres
ligatures (double s, &, etc.) dont, peut-être, on n'a on a
oublié de parler dans cette série de messages, en tout cas pas au
début (je n'ai pas encore lu la suite). L'une d'elle est le cai
(cay, kay, etc., c'est-à-dire « et » en grec) dont on
a parlé ici même en 1997 s. m. s. s. e., ligature plus connue sous
le nom de « ligature que », caractère qui, lorsqu'il
n'était pas disponible, était remplacé par la combinaison
« q; » (ainsi « atque » se trouve sous la
forme « atq; », ce qui déroute au premier abord les
personnes non prévenues). En dehors des ligatures proprement dites,
il y aussi des signes abréviateurs, dont le plus connu est sans
doute la tilde, laquelle est devenue par la suite le signe diacritique
que l'on sait, utilisé par exemple en espagnol.
Exemple (fragment de Ætius d'Amide, De
simplicibus pharmacis, éd. de Venise, 1544) :
La ligature « que » se trouve ici
dans « Quæcumque (quæcumq;) autem in ». On
aperçoit aussi le e à crochet (dit « ogonek ») et le
bien connu &.
- Y a-t-il des variantes de la langue
latine (latin d'Église, latin scolaire
moderne) où cette ligature est ou a été utilisée ?
Dépend-elle de la
prononciation adoptée ?
Non. Pendant toute une époque elle fut utilisée,
hormis lorsqu'elle manquait dans les polices, auquel cas elle était
remplacée par le doublet ae. La ligature est liée à la
prononciation qu'elle rend de manière plus fidèle, signalant
explicitement la diphtongue ae. (Tout groupement ae n'est pas une
diphtongue en latin, tel le ae de « aes », l'airain,
pour lequel fut tardivement introduit la marque ¨ pour indiquer la
diérèse.). La même remarque s'applique aussi à la ligature
oe.
- Dans les noms latins de la nomenclature
biologique internationale, on
employait la ligature mais récemment on aurait recommandé
officiellement de
ne plus l'utiliser. Il me semble que Jacques Melot en a déjà
parlé.
Ce n'est pas une simple recommandation, mais une
règle ! J'ai protesté, à l'époque, contre son introduction,
laquelle fut motivée, comme je l'avais appris en coulisse, par des
difficultés de traitement informatique chez les Anglais de Kew. En
réalité, on peut regarder ça comme ne s'agissant pas d'une
dégradation de l'écrit latin pour des raisons exogènes, mais d'un
retour aux sources qui tombait à pic pour les Anglais, si l'on peut
dire. En effet, le latin s'écrivait sans ligatures, lesquelles sont
apparues sous la plume des scribes du Moyen-Âge. Autrement dit, la
situation n'a pas le caractère scandaleux en soi qu'elle aurait en
français si, par exemple, on proposait de remplacer la ligature e
dans l'o pour faire des économies ou pour des raisons techniques
(raisons nécessairement mauvaises à notre époque, comme on
sait).
- Dans les quelques emprunts latins du
français courant où le problème se
pose, l'usage semble hésiter : le Petit Robert écrit
« curriculum vitæ » et
« ex æquo », alors que le Petit Larousse écrit ces
expressions sans
ligature, bien qu'il la maintienne dans des termes plus scientifiques
comme
« cæcum, cæcal » et « cæsium »
(cette dernière graphie perd d'ailleurs du
terrain devant la forme « césium», qui règle le
problème). Votre marche
perso ?
Le latin classique s'écrivant sans ligature et la
ligature æ n'appartenant pas au système de caractères utilisés
pour l'écriture du français pas plus que å ou ø (contrairement
à l'e dans l'o, ¦), je préfère la solution adoptée par le
Larousse (nom qui a l'heur de me rappeler à chaque fois Jean-Pierre
Lacroux). Quant aux mots que vous citez, ils figurent dans le
dictionnaire parce qu'on est encore (mais de moins en moins)
susceptible de les trouver sous cette forme dans des textes, mais ce
sont des formes de transition incomplètement francisées amenées
à l'être complètement tôt ou tard. Tel est le cas de
« cæsium », qui depuis au moins cinquante ans, s'écrit
la plupart du temps sous sa forme complètement francisée
(césium), bien qu'on sente maintenant, sous l'influence de l'anglais,
un certain retour de « cæsium », mais à vrai dire
pas très fort, sans doute parce qu'il ne s'agit que de l'anglais
britannique (les Américains utilisent plutôt
« cesium »). Il suffirait qu'un ouvrage médical de
référence d'une certaine importance adopte l'orthographe
« cécum », pour amorcer le mouvement aussi pour ce
terme. L'évolution vers cette variante stable étant inéluctable,
le plus tôt sera le mieux.
Jacques Melot
Jean Fontaine
- Re: [typo] Règles typo pour le latin, (continued)